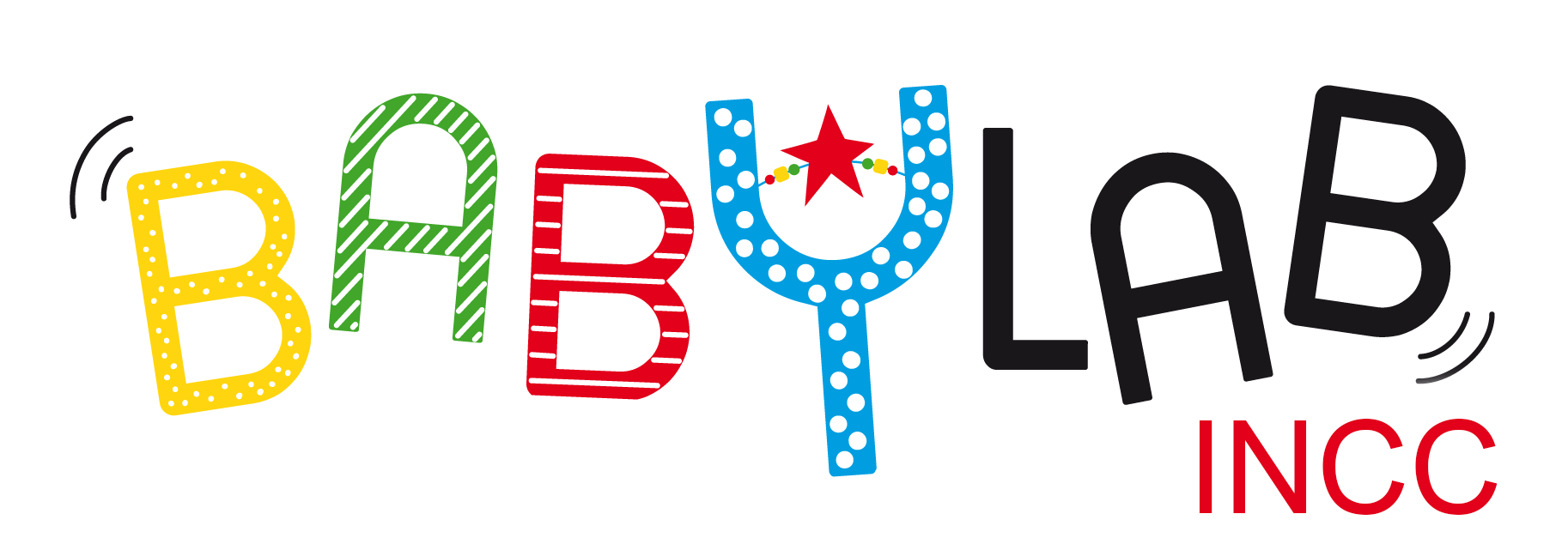Marianne Barbu-Roth
Chercheuse Associée

Le docteur Marianne Barbu-Roth (MBR) est actuellement associée au Centre Intégratif des Neurosciences et de la Cognition de l’Université Paris Cité et du CNRS où elle dirige le groupe Premalocom. Elle est titulaire d’un doctorat en Neurosciences et est spécialisée dans le domaine du développement moteur et locomoteur précoce des nourrissons. Elle a publié plusieurs articles sur l’ontogenèse de la locomotion humaine, remettant en cause l’idée que les humains naissent bipèdes et que la locomotion néonatale n’est qu’un réflexe spinal. Au contraire, des études récentes menées par son groupe révèlent que les nouveau-nés sont capables d’utiliser des circuits neurologiques quadrupèdes pour se propulser et que cette marche néonatale à quatre pattes est déjà contrôlée à un niveau supra-spinal par des stimuli visuels, olfactifs et auditifs. En suivant cette ligne de recherche, MBR et ses collègues ont conçu un nouveau dispositif, une mini planche à roulettes, appelée Crawliskate, pour stimuler la marche à quatre pattes dès l’âge du terme dans le but d’améliorer le développement sensorimoteur des nourrissons présentant un risque d’anomalie de leur développement moteur et locomoteur.
Liens pertinants: – Babies – Partie 1 Le quatre pattes
– Le super pouvoir des bébés : épisodes 3 et 4
Projets en cours
Publications Sélectionnées
Développement précoce des représentations cérébrales du corps chez le nourrisson : explorations en neuro-imagerie et comportement
Cette étude vise à mieux comprendre comment le cerveau du bébé perçoit et représente différentes parties de son corps dans les premiers mois après la naissance, en utilisant l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ainsi que des évaluations comportementales.

Collaboratrice du projet
Marianne Barbu-Roth
Effet d’un entraînement précoce à la marche à quatre pattes à l’aide d’un mini skate sur le développement locomoteur et moteur de grands prématurés cérébrolésés
Le projet consiste a évaluer la faisabilité et l’efficacité d’un entrainement précoce de 8 semaines dès la sortie de la néonatologie de stimulation à la marche quadrupède sur un mini skateboard, le Crawli skate, chez 50 grands prématurés présentant un haut risque de troubles du neurodéveloppement et suivi de manière longitudinale.

Collaboratrice du projet
Marianne Barbu-Roth
– Marie-Victorine Dumuids-Vernet, Vincent Forma, Joëlle Provasi, David Ian Anderson, Elodie Hinnekens, Evelyne Soyez, Mathilde Strassel, Léa Guéret, Charlotte Hym, Viviane Huet, Lionel Granjon, Lucie Calamy, Gilles Dassieu, Laurence Boujenah, Camille Dollat, Valérie Biran and Marianne Barbu-Roth (2023) Stimulating the motor development of very premature infants: effects of early crawling training on a mini-skateboard. Frontiers in Pediatrics, vol11, DOI 10.3389/fped.2023.1198016
– Marianne Barbu-Roth (2023) La motricité au cœur des troubles du neuro développement de l’enfant. Enfance, vol 4, pp 321-331
– Marianne Barbu-Roth, Evelyne Soyez-Papiernik, et Marie-Victorine Dumuids-Vernet (2023). Stimuler la motricité sur le Crawliskate. Enfance, vol 4, pages 339 à 368